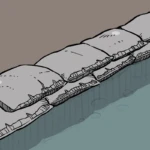Inondations en Belgique : 4 ans après les inondations de 2021, quel avenir pour la prévention et la protection ?
En juillet 2021, la Belgique a traversé l’une des catastrophes naturelles les plus marquantes de son histoire récente. Les inondations qui ont frappé le pays du 14 au 16 juillet ont causé des dégâts spectaculaires : près de 50,000 habitations touchées, 11,000 véhicules détruits, et un coût total estimé à près de 2,57 milliards d’euros. Cette tragédie, qui restera gravée dans la mémoire collective, continue aujourd’hui d’influencer profondément la façon dont la prévention et la gestion des risques climatiques sont envisagées en Belgique et en Europe.
Un bilan d’indemnisation historique et des défis persistants
Quatre ans après cette catastrophe, la quasi-totalité des 73,790 dossiers de sinistres a été traitée. Le secteur de l’assurance belge, coordonné par Assuralia, a répondu à la hauteur de l’événement : plus de 96% des victimes ont été intégralement indemnisées, pour un total de 2,24 milliards d’euros, ce qui représente environ 87% du coût total des dégâts matériels remontés. Seuls 1% des dossiers sont encore en cours de traitement, principalement en raison de sinistres majeurs concernant de grandes institutions ou des collectivités. Cette performance place la Belgique parmi les pays les plus efficaces d’Europe en matière d’indemnisation post-catastrophe.
Pourtant, ce succès opérationnel ne masque pas les failles révélées par la crise. Comme l’a souligné Assuralia dans son dernier rapport, le cadre légal reste perfectible. Malgré le quadruplement récent du plafond légal de couverture d’assurance, désormais fixé à 1,8 milliard d’euros, la réglementation ne garantit pas encore une protection adaptée en cas de catastrophe climatique d’ampleur inédite. L’absence d’un partenariat public-privé structurant ralentit la mise en place d’une solution durable pour l’indemnisation et la protection des citoyens belges face à des risques croissants. Aujourd’hui, la nécessité d’une réforme légale, harmonisée avec les attentes du secteur de l’assurance et des pouvoirs publics, s’affirme comme une priorité absolue pour préparer la Belgique aux prochaines décennies.
La prévention, levier incontournable de la résilience
Au-delà de la seule indemnisation, la prévention s’impose plus que jamais comme le pilier central d’une vraie politique de résilience climatique. La tendance est désormais claire : il ne s’agit plus uniquement de réparer, mais d’anticiper et de protéger efficacement avant que la catastrophe ne frappe. Le secteur de l’assurance, en collaboration avec le secteur de la construction (via Embuild), a récemment lancé le Moniteur des dommages climatiques, une plateforme interactive pour visualiser les dégâts par commune sur la dernière décennie. Ce nouvel outil permet à la fois aux autorités et aux acteurs privés d’identifier les zones vulnérables et de prendre des mesures ciblées, qu’il s’agisse de réaménagement urbain, d’investissements dans les infrastructures ou de systèmes de protection individuelle.
De plus, des lignes directrices techniques ont été rédigées pour inciter les promoteurs, gestionnaires de bâtiments et entreprises à intégrer la résilience dès la conception ou la rénovation de leurs biens. Même si la réglementation actuelle n’impose pas encore de normes de protection généralisées contre les inondations, l’initiative privée et la mobilisation citoyenne progressent rapidement, portées en partie par les retours d’expérience édifiants des épisodes de 2021.
Marché des solutions anti-inondation : croissance rapide et innovation
En réponse à la multiplication des phénomènes hydrauliques extrêmes, le marché européen des solutions de protection contre les inondations est en plein essor. Les besoins sont de plus en plus spécifiques, notamment dans le secteur commercial, industriel et tertiaire, où la continuité d’activité est un enjeu vital. Selon les dernières études sectorielles, le marché des barrières anti-inondation devrait enregistrer une croissance annuelle régulière jusqu’en 2032, atteignant près de 23 milliards USD à l’échelle mondiale.
Les barrières amovibles et modulaires occupent ainsi une place déterminante dans la stratégie de protection des bâtiments à usage professionnel. Ces systèmes, souvent réalisés en aluminium ou matériaux composites, combinent robustesse, légèreté et rapidité de déploiement. Installables par une seule personne en quelques minutes, ils représentent aujourd’hui la référence du marché pour les grands ensembles commerciaux, les parkings souterrains ou les locaux techniques. Certains modèles sont même capables de protéger linéairement jusqu’à 10 mètres de façade grâce à un système emboîtable, idéal pour les zones à risque identifiées par le Moniteur des dommages climatiques.
L’intégration croissante des technologies connectées (capteurs IoT, stations hydrométriques intelligentes, analyse de données en temps réel) transforme aussi la donne. En permettant l’activation automatisée des barrières ou l’envoi d’alertes précoces, ces innovations renforcent le caractère prédictif et adaptatif des dispositifs de protection. Il s’agit d’une avancée majeure pour les entreprises souhaitant investir dans la prévention et la protection sans grever leur fonctionnement quotidien.
Normes et cadre réglementaire : une harmonisation indispensable en Europe
La Directive européenne inondation (2007/60/CE) impose à chaque État membre d’identifier, cartographier et gérer les risques d’inondation selon une démarche intégrée et pluriannuelle. L’un des grands enjeux actuels concerne l’harmonisation des normes techniques et des réglementations nationales pour faciliter la mutualisation des innovations et leur adoption à grande échelle dans tous les pays de l’Union européenne.
En Belgique, la Wallonie et la Flandre déploient des programmes de résilience fondés à la fois sur la prévention technique (solutions de protection individuelle ou collective) et sur l’aménagement du territoire, en intégrant les zones naturelles d’expansion des crues dans le développement urbain. Malgré ces avancées, une récente étude a révélé que seules 77% des politiques urbaines intègrent un niveau suffisant de protection des infrastructures stratégiques (voiries, réseaux, etc.), alors que les infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, EHPAD) restent souvent insuffisamment prises en compte dans les plans de gestion des risques.
Cette situation justifie la mise en place, par plusieurs acteurs privés, d’équipes pluridisciplinaires dédiées aux audits de vulnérabilité et à la conception de solutions personnalisées pour chaque secteur d’activité. Les barrières amovibles et sacs anti-inondation, fiables et certifiés, sont dès lors intégrés au sein d’une stratégie globale, aux côtés des bassins de rétention et des dispositifs paysagers fondés sur la nature (jardins de pluie, toitures végétalisées, etc.).
Changement climatique, urbanisation et projections : la donne évolue
Le changement climatique poursuit son accélération et modifie les paramètres de risque structurels. Au rythme actuel, l’Agence européenne de l’environnement prévoit que le nombre de personnes exposées aux inondations côtières et fluviales pourrait tripler d’ici la fin du siècle en Europe de l’Ouest. Les cartes de prévision du GIEC indiquent une intensification des précipitations orageuses et des crues éclairs sur le Nord-Est de la France, le Benelux et l’ouest de l’Allemagne dès la prochaine décennie.
Dans ce contexte, la résilience urbaine ne peut reposer exclusivement sur le secteur public ou les compagnies d’assurance. L’implication des acteurs économiques—maîtres d’ouvrage, entreprises industrielles, promoteurs, gestionnaires de parcs d’activités—devient le moteur du changement. Investir dans la prévention aujourd’hui, c’est diminuer drastiquement le coût humain et financier des catastrophes futures, tout en préservant la compétitivité des entreprises et la sécurité des territoires.
Professionnalisation et transparence : un enjeu de confiance
L’un des enseignements majeurs de la catastrophe de 2021 réside dans la nécessité de renforcer la confiance entre les experts, les assureurs et les citoyens ou entreprises sinistrés. Pour répondre à ce besoin, un nouveau code de conduite a été introduit par Assuralia et l’association belge des experts en dommages. Ce cadre promeut la professionnalisation, la transparence et l’indépendance des missions d’expertise, tout en imposant des critères précis de formation et de déontologie. Pour les décideurs B2B, cette évolution est déterminante : elle assure que les évaluations de risque et le dimensionnement des solutions anti-inondation seront réalisés de façon objective, indépendante et en adéquation avec la réalité technique du terrain.
Technologies de protection : barrières amovibles, sacs anti-inondation et nouvelles normes
Les barrières amovibles pour bâtiments commerciaux et industriels ont atteint un niveau de technicité remarquable. La modularité, la résistance mécanique et la certification CE sont devenues des standards indispensables. En Belgique, plusieurs fabricants et partenaires proposent des dispositifs basés sur le principe du « plug & play » : la barrière reste discrète hors alerte, ne nécessite ni génie civil lourd ni permis spécifique, et se met en œuvre en quelques minutes quand l’alerte crue est lancée.
Les sacs anti-inondation, à base de polymères super-absorbants, se substituent avantageusement aux traditionnels sacs de sable, en offrant une mise en œuvre rapide, propre et sans nuisance pour l’environnement. Capables de gonfler en quelques secondes au contact de l’eau, ils mobilisent moins de main-d’œuvre et présentent une compacité inégalée pour le stockage et le transport, un atout majeur pour les gestionnaires de sites logistiques ou de centres commerciaux.
Les systèmes intelligents, couplés à des capteurs fixés sur les points sensibles (trappes de caves, portes, soupiraux…), permettent d’automatiser l’alerte et de piloter le déploiement des barrières à distance. Cette fusion du physique et du numérique ouvre la voie à la gestion intégrée et à la maintenance prédictive, deux éléments clefs de la sécurisation des installations sensibles en environnement urbain ou semi-urbain.
Prévention, innovation et mutualisation : les piliers de l’avenir
L’avenir de la protection contre les inondations en Belgique résidera dans la capacité des acteurs à mutualiser les meilleures ressources : veille technologique permanente, analyse des données climatiques, retours d’expérience et normalisation des procédures. Le Moniteur des dommages climatiques, les audits de vulnérabilité et l’utilisation croissante d’ingénierie collaborative démontrent que la Belgique est engagée sur la voie de la résilience proactive, à la croisée de l’exigence réglementaire européenne et des attentes concrètes du monde économique et de la société civile.
Pour les entreprises et les décideurs chargés de la sécurité de leurs bâtiments, il est crucial de s’entourer d’experts capables d’identifier les solutions de protection les plus adaptées à chaque configuration. Les investissements réalisés aujourd’hui dans la prévention, qu’il s’agisse de barrières amovibles, de sacs anti-inondation innovants ou de systèmes de télémétrie avancée, seront les garants de la sécurité et de la compétitivité de demain.
En conclusion, la gestion post-catastrophe de 2021 a démontré l’efficacité du système belge sur le plan opérationnel, mais aussi la nécessité de repenser en profondeur la prévention et la préparation aux risques climatiques. Dans un contexte où la fréquence des inondations va s’accroître, chaque acteur doit devenir pleinement responsable et acteur de sa propre sécurité. L’anticipation, l’innovation et la coopération entre le secteur privé, les autorités et les citoyens forgent désormais le socle d’une Belgique mieux protégée et capable de faire face avec sérénité à la réalité des changements climatiques.