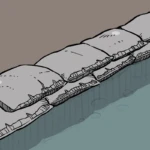Inondations : un lourd bilan climatique de 12 à 15 milliards d’euros en Belgique (2000‑2023)
Les événements climatiques extrêmes coûtent chaque année des milliards d’euros en Europe. En Belgique, la facture est estimée entre 12 et 15 milliards d’euros sur la période 2000-2023, d’après l’Agence européenne pour l’environnement (EEA). Ces pertes économiques sont principalement dues aux catastrophes naturelles hydrométéorologiques – inondations en tête – qui constituent le principal facteur de dégâts matériels. À titre d’exemple marquant, les inondations de juillet 2021 ont dévasté une partie du pays, illustrant tragiquement l’ampleur des risques climatiques auxquels la Belgique (et ses voisins) font face. Outre le coût financier, ces catastrophes ont des conséquences humaines dramatiques et posent la question de l’efficacité de l’assurance inondation en Belgique et en France. Dans cet article, nous faisons le point sur le bilan 2000-2023, les enseignements des inondations de 2021, l’état de la couverture assurantielle dans les deux pays, et les pistes de prévention et d’adaptation pour améliorer la résilience climatique face à ces événements.
Coût des catastrophes climatiques : les inondations en tête des pertes
Selon les données récemment publiées par l’EEA, la Belgique figure parmi les pays européens les plus touchés par les pertes économiques liées aux aléas climatiques depuis le début du siècle. Pour la période 2000-2023, le montant cumulé des dommages s’élève à 12-15 milliards d’euros. Cela place la Belgique dans un groupe intermédiaire de pays européens fortement impactés, derrière des grandes nations comme l’Allemagne (180 milliards € depuis 1980) ou la France (~130 milliards €). Ramené à la superficie du pays, ce coût est même exceptionnellement élevé : près de 554 000 € de dommages par km² en Belgique, soit le 2^e pays le plus impacté d’Europe sur ce critère, après la Slovénie.
Les inondations constituent la première source de dégâts financiers liés au climat en Belgique, suivies par les tempêtes (vents violents et grêle). À l’échelle européenne, une tendance similaire se dessine : les inondations et autres événements hydrologiques sont responsables de la plus grande part des dommages économiques dus au changement climatique. En revanche, les vagues de chaleur (et dans une moindre mesure les vagues de froid, sécheresses et incendies) provoquent la majorité des décès liés aux aléas climatiques. Autrement dit, les inondations et tempêtes coûtent cher en euros, tandis que les canicules coûtent surtout des vies humaines.
Il est important de noter que ces pertes financières considérables ne sont que partiellement couvertes par les assurances. D’après l’EEA, plus de 50% des dégâts dus aux catastrophes climatiques extrêmes ne sont pas assurés dans la plupart des pays, un “gap de protection” qui dépasse même 90% dans de nombreux cas. La Belgique ne fait pas exception : malgré une bonne pénétration de l’assurance habitation, une portion significative des dommages climatiques reste à la charge des sinistrés ou des pouvoirs publics. Cette situation interroge sur la capacité de nos sociétés à absorber financièrement des catastrophes de plus en plus fréquentes. En effet, le GIEC (IPCC) constate déjà une augmentation de la fréquence et de l’intensité de certains extrêmes météorologiques en Europe, tendance amenée à s’aggraver avec la poursuite du réchauffement. Les projections européennes indiquent notamment que le changement climatique risque d’accroître la fréquence des inondations sur le continent dans les années à venir.
Juillet 2021 : l’inondation du siècle en Belgique
Des voitures emportées et empilées par les flots à Verviers lors des inondations de juillet 2021, en Belgique.
L’été 2021 a donné lieu à l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire moderne belge. Du 14 au 16 juillet 2021, des pluies diluviennes records se sont abattues sur le sud du pays, provoquant des crues dévastatrices sur plus de 200 communes principalement en Wallonie. Le bilan humain est tragique : 39 personnes ont perdu la vie dans ces inondations historiques. Environ 100 000 sinistrés – soit des familles ou individus touchés par des dégâts – ont été recensés, illustrant l’ampleur sans précédent de la catastrophe.
Les dégâts matériels sont tout aussi impressionnants. On estime que près de 48 000 bâtiments (dont 45 000 logements) ont été endommagés ou détruits par les eaux. Des infrastructures vitales ont souffert : plus de 550 ponts et des centaines de routes, d’ouvrages d’art et d’installations publiques ont été détruits ou gravement endommagés. Quelque 11 000 véhicules ont également été perdus dans les flots. Certaines localités ont vu des quartiers entiers ravagés, laissant des milliers de familles sans logement du jour au lendemain. Au plus fort de la crise, des dizaines de milliers de foyersétaient privés d’électricité, de gaz ou d’eau potable.
Sur le plan financier, les inondations de juillet 2021 ont représenté un choc économique colossal. Les assureurs belges ont traité plus de 70 000 dossiers d’indemnisation pour ce sinistre. Les dommages assurés (couverts par les contrats d’assurance) s’élèvent à environ 2,5 milliards d’euros, ce qui en fait de loin le sinistre naturel le plus coûteux qu’ait connu le pays. Or cette somme ne reflète qu’une partie de la réalité : en incluant les dommages non assurés – notamment la destruction d’infrastructures publiques – le coût total des inondations de 2021 atteint environ 5 milliards d’euros. Autrement dit, près de la moitié des pertes n’étaient pas couvertes par les assureurs.
Face à l’ampleur du désastre, les pouvoirs publics et le secteur privé ont dû improviser une réponse exceptionnelle. En Wallonie, un fonds des calamités régional existait, mais sa dotation était insuffisante pour faire face à un sinistre de cette magnitude. Le gouvernement wallon et les assureurs ont donc négocié un accord inédit pour indemniser intégralement les victimes. Les compagnies d’assurance ont accepté de dépasser leurs limites contractuelles, tandis que les autorités régionales et fédérales ont injecté des moyens financiers d’urgence. Grâce à cet effort conjoint, 100% des pertes économiques (environ 5 milliards €) ont finalement été compensées aux sinistrés, alors qu’en temps normal les assureurs n’étaient légalement tenus de couvrir qu’un montant maximal bien inférieur. Ce sauvetage in extremis a été salué, mais il a aussi mis en lumière la nécessité de mieux préparer notre système d’indemnisation pour de futures catastrophes de grande ampleur.
Assurance inondation : quelle couverture en Belgique et en France ?
Les récents événements ont suscité un débat sur l’assurabilité des catastrophes climatiques majeures comme les inondations. Bonne nouvelle, la Belgique et la France font partie des pays où la couverture assurantielle des catastrophes naturelles est relativement élevée. Dans les deux pays, l’assurance habitation inclut obligatoirement la garantie “catastrophes naturelles”, ce qui signifie que tout détenteur d’une police incendie est automatiquement couvert contre les inondations, tempêtes et autres périls climatiques courants. Ce régime obligatoire assure une mutualisation du risque à l’échelle nationale, évitant qu’une large part de la population ne reste sans protection. En comparaison, d’autres pays voisins comme l’Allemagne ou le Luxembourg laissent cette couverture optionnelle, entraînant un taux d’assurance beaucoup plus faible et obligeant l’État à payer la majorité de la facture en cas de catastrophe.
Cependant, malgré une base commune, les systèmes français et belge présentent des différences importantes. En France, l’État joue un rôle déterminant via un mécanisme de réassurance publique. Une taxe spécifique sur chaque contrat d’assurance alimente un fonds public (géré par la Caisse Centrale de Réassurance, CCR) qui intervient pour couvrir les sinistres catastrophiques dépassant les capacités normales des assureurs. Cela garantit qu’en cas d’événement extrême (inondation majeure, sécheresse exceptionnelle, etc.), les assureurs français bénéficient d’un filet de sécurité financier pour indemniser intégralement les sinistrés. Ce modèle de partenariat public-privé existe depuis plusieurs décennies en France et a fait ses preuves, permettant par exemple d’indemniser rapidement les victimes des tempêtes de 1999 ou de multiples inondations dans les années 2010.
En Belgique, le dispositif est moins centralisé. En théorie, ce sont les Régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles) qui devraient compléter l’intervention des assureurs en cas de catastrophe naturelle majeure, via leurs fonds des calamitésrespectifs. Toutefois, comme l’a montré 2021, la capacité financière de ces fonds régionaux est limitée face à un scénario extrême. La législation belge prévoit d’ailleurs un plafond légal d’environ 1,6 milliard d’euros pour l’intervention totale des assureurs privés sur un sinistre catastrophique. Au-delà de ce montant, rien n’est formellement établi quant à la prise en charge – ce qui crée une incertitude pour les victimes en cas d’événement dépassant ce seuil. Or, l’inondation de 2021 a largement excédé ce plafond (en coût total), nécessitant des arrangements ad hoc. Comme l’illustre une projection d’Assuralia, si une “bombe à eau” similaire survenait aujourd’hui dans une grande ville comme Gand, les dégâts pourraient atteindre 9 milliards €, soit bien au-delà de la couverture assurée disponible actuellement.
Ces constats ont poussé les acteurs du secteur à réclamer une réforme du cadre assurantiel en Belgique. L’idée serait de mettre en place un partenariat public–privé structuré pour la gestion des catastrophes naturelles majeures. Un tel système définirait clairement la part de risque prise en charge par les assureurs et celle garantie par l’État (ou les Régions), afin d’assurer une indemnisation rapide et complète des sinistrés même en cas de crise extrême. Les autorités européennes (BCE, EIOPA) encouragent d’ailleurs ce type de mutualisation des risques au niveau de l’UE. L’enjeu est de maintenir notre société assurable malgré l’aggravation des aléas climatiques : sans une adaptation du modèle, on peut craindre à terme soit une explosion des primes d’assurance, soit un retrait des assureurs de certaines zones à haut risque (comme on l’observe déjà en Californie face aux incendies). En France, des évolutions sont également en discussion pour pérenniser le régime CatNat face à la multiplication récente des sinistres (sécheresse 2022, grêlons géants, inondations répétées dans le Pas-de-Calais en 2023, etc.). Des deux côtés de la frontière, l’assurance inondation est donc un pilier de la résilience financière, mais qui devra innover et se renforcer pour absorber les chocs à venir.
Prévention des inondations et renforcement de la résilience climatique
Si l’assurance permet de réparer après coup, il est tout aussi crucial d’agir en amont pour prévenir les inondations et limiter leurs impacts. Les inondations de 2021 ont joué un rôle d’électrochoc et mis en lumière plusieurs axes d’amélioration possibles en Belgique (valables tout autant en France). Les experts et autorités appellent ainsi à renforcer la résilience climatique de nos territoires via des mesures concrètes d’adaptation:
- Systèmes d’alerte précoce efficaces : Améliorer la détection et surtout la diffusion des alertes météo critiques. En juillet 2021, des signaux d’alarme avaient été émis par le système européen EFAS quelques jours avant les crues, mais la communication aux populations et la traduction locale de ces alertes se sont avérées insuffisantes. À l’avenir, il faut affiner la coordination entre services météo, autorités et citoyens pour évacuer ou protéger à temps les zones menacées. Des sirènes, SMS d’alerte géolocalisés et exercices de préparation peuvent sauver des vies en cas d’urgence.
- Aménagement du territoire et urbanisme adapté : Réviser nos plans d’urbanisme pour éviter de construire dans les zones inondables à risque. De nombreuses habitations gravement touchées en 2021 étaient situées en plaine inondable non protégée. Il est indispensable de cartographier précisément les zones à risque et d’y imposer des restrictions de construction. Pour les bâtiments existants ou incontournables, on doit intégrer des normes anti-inondation dans la construction : fondations plus profondes, matériaux résistants à l’eau, conception permettant une évacuation facile des eaux, etc.. Par ailleurs, renaturer certaines zones pour qu’elles servent de plaines d’expansion des crues est une solution gagnant-gagnant : redonner aux rivières des espaces où déborder sans dommages majeurs. De tels « zones tampons » absorbent l’eau en cas de crue, protégeant les zones habitées en aval.
- Infrastructures et ouvrages de protection : Investir dans le renforcement ou la création d’ouvrages destinés à réguler les crues. Par exemple, augmenter la capacité de certains barrages réservoirs ou bassins d’orage pour retenir l’eau lors de pluies intenses. De même, aménager des digues et berges végétalisées peut aider à contenir les cours d’eau en crue tout en respectant l’environnement. En zone urbaine, multiplier les surfaces perméables(parcs, noues végétales, parkings drainants) permet de réduire le ruissellement et d’éviter que chaque orage ne tourne à l’inondation flash. Ces approches de « ville perméable » et d’urbanisme vert apportent un double bénéfice : moins d’inondations et un cadre de vie amélioré.
- Sensibilisation et initiatives individuelles : Impliquer les citoyens et les entreprises dans la culture de la prévention. En Belgique, la fédération des assureurs Assuralia a récemment lancé un “moniteur des dommages climatiques” interactif, qui permet à chacun de consulter l’historique des sinistres inondation et tempête par commune sur la dernière décennie. L’outil vise à informer les pouvoirs publics locaux et les particuliers sur leur exposition, afin d’encourager des actions préventives. Par exemple, une commune voyant un risque élevé d’inondation pourra investir dans des travaux de drainage ou de protections riveraines. Un ménage sachant sa maison en zone inondable pourra installer des barrières anti-crue amovibles, revoir la hauteur des seuils de portes, ou placer les équipements sensibles en hauteur. Ces gestes de résilience locale, encouragés par les assureurs et les autorités, complètent utilement les grands travaux : ils réduisent la vulnérabilité et pourraient même devenir des conditions pour être bien assuré demain.
Enfin, au-delà des mesures physiques, c’est toute notre politique de gestion du risque climatique qu’il faut adapter. Les experts appellent à intégrer systématiquement le critère “changement climatique” dans les décisions d’urbanisme, d’infrastructure et de budget. Chaque euro investi aujourd’hui dans l’adaptation (que ce soit un rempart anti-inondation, un système d’alerte modernisé ou la restauration d’une zone humide naturelle) permettra d’en économiser plusieurs lors du prochain épisode extrême. Renforcer la résilience climatique de la Belgique et de la France est un défi de long terme : il implique une collaboration étroite entre scientifiques, pouvoirs publics, secteur de l’assurance, entreprises et citoyens. Les inondations catastrophiques de 2021 ont été un douloureux révélateur, mais elles peuvent aussi servir de leçon pour bâtir un avenir moins vulnérable. Investir dans la prévention des inondations, s’assurer que chacun soit correctement protégé financièrement, et réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour contenir le dérèglement du climat : ce triple effort est indispensable pour que les catastrophes naturelles de demain ne se transforment pas en catastrophes humaines et économiques incontrôlées. En somme, face à des risques climatiques amenés à s’intensifier, anticiper et s’adapter restent nos meilleurs atouts pour limiter le coût des inondations futures – qu’il soit matériel ou humain.
Sources : Agence européenne pour l’environnement (EEA), Institut royal météorologique (IRM), SPF Environnement, Assuralia, GIEC, etc.